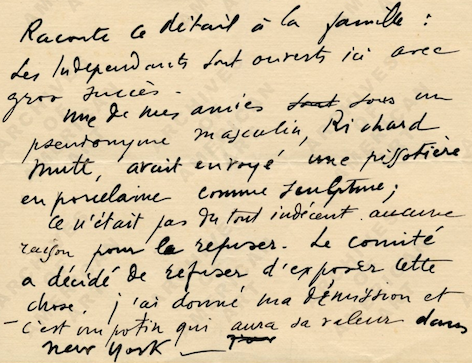”Fondé en 1992 et situé à Saint-Jean-Port-Joli (Québec) en bordure du fleuve Saint-Laurent, Est-Nord-Est (ENE) est un lieu autogéré de recherche en art actuel, et l’un des acteurs importants dans le domaine en dehors des grands centres. Son objectif premier : offrir à une communauté internationale d’artistes, d’auteurs et d’autrices un espace et du temps d’expérimentation ainsi qu’un accès privilégié à des ressources et des savoir-faire locaux diversifiés. Il promeut la valeur que représente le processus de création dans les pratiques artistiques contemporaines.
Le centre invite les résidents et résidentes à investir librement de nouveaux territoires de création, sans qu’un objectif de production prédéterminé ne soit lié à un impératif de diffusion. Son offre de résidences répond à un besoin manifeste des artistes, des autrices et des auteurs établis et émergents du champ large des arts visuels du Québec, du Canada et de l’international, pour lesquels le fait de bénéficier d’un contexte entièrement voué à l’exploration est essentiel au développement professionnel de leur pratique.”



J’entretiens avec Est-Nord-Est une relation toute particulière. J’y rencontre A-M, alors archiviste des lieux, pour collaborer avec la Biennale de sculpture qui m’emploie pour l’été. Après plusieurs tentatives, avant, pendant et après le réaménagement des lieux pour les splendides bâtiments occupés aujourd’hui, le comité de programmation me propose une résidence à l’hiver 2021, qui pour des raisons pandémiques aura finalement lieu un an plus tard, en février et mars 2022. J’y vis toutes sortes de choses que je médite encore, et ai la chance d’y retourner quelques mois plus tard pour mettre des disques pendant quelques heures à l’occasion du 30ème anniversaire. Enfin, j’y vais à l’automne 2022 pour rencontrer les résident-e-s de la saison et les présenter en courts textes, ci-dessous :
Gabrielle Desgagné-Duclos
Auteure et travailleuse de l’art, Gabrielle Desgagné-Duclos se dépose à l’hiver 2023 en résidence à Est-Nord-Est avec un projet d’écriture aux contours mouvants, dont le préalable à la réalisation serait la recherche d’une légitimité auctoriale. Il s’agit du genre d’autorité que personne d’autre que nous-même ne peut nous offrir, en accord avec nos propres doutes et mesurée face à nos ambitions. Puisqu’écrire c’est d’abord (se) lire, le temps et l’espace dédié à cette activité et ses prolongements sont déterminants. Ainsi, l’auteure déploie une part de sa bibliothèque au sol et tout autour d’elle pour se construire un espace de travail. Ici, la présence conjointe de l’espace de vie, en contre-plongée, noue architecturalement les moments de loisirs et de repos, et ceux de travail. Rendu confortable, l’espace de création sert de lieu de rencontre entre une pensée dégagée d’obligations immédiates et celle d’autres auteur·e·s. Les passages marquants d’œuvres littéraires, d’essais, peuvent être reçus et médités. L’auteure entretient un rapport critique, et ancré dans la pratique, avec les conditions d’action des travailleurs et travailleuses culturel·le·s qui rendent possible, par leur labeur souvent peu visible, les gestes de production, de diffusion et de médiation avec le public. Seulement parfois, c’est pour soi-même que l’on peut vouloir travailler et écrire, même si l’on veut aussi parler des autres. Informée notamment par une perspective intellectuelle propre à l’histoire de l’art, usant du rapport citationnel, de l’intertextualité, de la circulation des images et de la stimulation tirée des cultures visuelles, Desgagné-Duclos mentionne néanmoins chercher à s’éloigner de l’écriture dite académique au profit de quelque chose de plus personnel, libre, situé. Une piste riche est celle de l’autothéorie, approche conceptuelle encourageant artistes et auteur·e·s à réfléchir à partir de leur propre vie, en écho à la cruciale proposition féministe voulant que le privé soit toujours politique. Desgagné-Duclos cherche à construire des ponts entre intimité, théorie et création.

Le lieu et la méthode de transmission des savoirs dont bénéficie un individu dans sa jeunesse sont déterminants pour son cheminement intellectuel et politique. Pour l’artiste, ils constituent un socle d’influences et de pratiques sociales qui ne peuvent que peser durablement sur sa pratique. L’artiste d’origine ukrainienne Slinko, installée aux États-Unis depuis plusieurs années, mobilise dans son travail un ensemble de référents sociohistoriques précis depuis une perspective étroitement liée à son parcours de l’enfance à l’âge adulte. Issue d’une famille dont les ancêtres étaient polonais, elle grandit à Bakhmout, dans le Donbass, pour ensuite étudier à Kharkiv. Dans cette période de transition entre les 20e et 21e siècles, l’influence directe du voisin russe tendait à reculer, et des identités nationales plus distinctes se développaient dans les anciennes Républiques socialistes. Si les techniques éducatives propagandistes du régime soviétique n’étaient plus directement à l’œuvre, leur influence sur le parcours scolaire de la jeunesse ukrainienne demeurait. Curieuse d’apprendre l’art et le design, Slinko a effectué une partie de sa formation dans un bâtiment hérité de l’ère soviétique, dont l’architecture communale avait servi autrefois aux Young Pioneers, cette aile jeunesse du Parti communiste qui se devait de développer une littératie propre aux idéaux du régime. Lors de sa résidence à Est-Nord-Est, Slinko entreprend de réaliser la maquette d’une bourse du travail, sorte de club de travailleurs·euses voué à l’éducation populaire. À partir de cette forme architecturale héritée des gouvernements socialistes, elle produit un moule destiné à la fabrication d’un modèle réduit du bâtiment en glace. On peut y lire une métaphore de l’effondrement des institutions politiques et la liquidation des biens publics au moment de la chute de l’URSS, mais aussi un hommage à un type d’architecture dédié à l’instruction. Au cours d’un passage à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, l’artiste s’était déjà intéressée à l’importance du campus, du lieu d’apprentissage collectif, en explorant les vestiges d’une école d’art dessinée vers 1989 par l’architecte moderniste Ricardo Ligorreta. Déjà désaffecté, sans soutien public conséquent, ce campus présente le dilemme des institutions trop innovantes qui parfois font faillite, se ruinant à vouloir renouveler les formes. L’atelier témoigne également de l’attirance de Slinko pour les mauvaises herbes. Elle reproduit en métal découpé ces végétaux adaptatifs, espèces rudes et malines que l’agro-industrie, pourtant puissante, n’arrive pas à éliminer ni à en tirer profit. Il y a aussi de larges cyanotypes réalisés à partir de grillages et barrières découvertes lors de promenades dans la région. Ici la séparation et les frontières, celles que l’on désire, mais aussi celles que l’on nous impose ou que l’on défend, sont retournées à leur fragilité intrinsèque. Dans son travail, l’artiste propose une réévaluation de l’histoire sans binarité, évacuant une histoire de tension entre blocs et cherchant plutôt à déconstruire avec humour et intelligence la matrice conceptuelle productiviste des sociétés en quête périlleuse de croissance éternelle.

Annie Charland Thibodeau travaille à l’édification de nouveaux rapports à la monumentalité en abordant dans sa pratique sculpturale l’objet non pas comme élément indépendant, pouvant se suffire à lui-même et être déplacé, mais plutôt en prenant compte de son intégration à un environnement, en cherchant parfois à rendre cet environnement englobant. Forte de sa connaissance approfondie de la matérialité de la pierre de taille, de ses propriétés, ses difficultés et ses limites, l’artiste a profité de l’expérience de résidence pour développer, dans le travail de la matière, une approche plus expérimentale. De la même façon, Charland Thibodeau a combiné dans des moules aux formes polygonales des matériaux locaux, tels que le quartz et le mica, à l’argile crue et à la poudre de marbre et de granit, faisant apparaître de délicates tuiles arborant un éventail de textures et de comportements face à la lumière, avec une translucidité parfois proche de la porcelaine. Dans ces compositions en céramique, ce sont des points de tension imprévisibles qui émergent à partir de cristallisations et de refroidissements. Ces essais s’appuient sur des savoirs pratiques et scientifiques inspirés du mentorat de la céramiste Marianne Chénard et de l’échange avec des personnes issues de professions où la pierre et ses déclinaisons sont au cœur de l’ouvrage : pétrographes, géologues, architectes. Ces rencontres ont été rendues possibles grâce à la résidence de longue durée réalisée avec le soutien du centre Bang, à Chicoutimi. L’artiste a également pu examiner des lames de pétrographies, des couches de pierre d’environ trente microns collées sur des plaques de verre, révélant au microscope les structures internes des minéraux. Dans cette approche sensible de la science et de l’art, l’artiste travaille avec des rebuts issus de l’industrie et expérimente des techniques inédites, comme cette gravure au laser effectuée sur des éclats de granit noir réalisée en amont de la résidence, dont l’apparence, après le passage du faisceau de lumière, se rapproche de l’obsidienne. La pierre qu’on imagine pérenne, immuable, est en fait une matière changeante, marquée par le passage du temps, l’érosion, les écarts de chaleur. Son mouvement est lent et progressif, il appartient à des temps géologiques avec lesquels nous n’avons pas de rapport direct. Malgré tout, comme tout matériau, l’utilisation de la pierre engendre un certain impact environnemental, nous amenant à remettre en question ce que l’on génère, ce que l’on gaspille. Sans écarter la récupération et le réemploi inhérents à la pratique artistique, l’artiste parvient à nous mettre en contact avec le poids physique, historique et conceptuel de la pierre et ses déclinaisons.

Après avoir séjourné en Europe, en Asie et en Afrique, l’artiste franco-allemand Jérôme Chazeix trouve de nouveaux repères dans la vallée du Saint-Laurent, en s’ancrant dans la communauté du village de Saint-Jean-Port-Joli. Il y fait rapidement la rencontre de Peggy Bélanger, soprano du chœur La Marée Chante et artiste ouverte à la cocréation et aux rencontres fécondes. Chazeix initie six choristes de l’ensemble local au chant féral, approche déconstruisant l’expression vocale en groupe et permettant improvisations et expérimentations. En explorant de manière originale la puissance du collectif et la créativité particulière qu’amène l’exploration libre, Chazeix et les vocalistes composent les paroles d’un long chant intitulé Rituel pour un fleuve, sorte de poème épique louant la force et les énergies de l’affluent. En vue d’une première performance à Est-Nord-Est en fin de résidence, puis d’une seconde dans la marina du village, sur un voilier à quai et autour de celui-ci, l’artiste élabore un environnement scénographique total fait de portails en bois et en bambou et d’oripeaux pastel dont les motifs ne célèbrent ni rois ni patries, mais plutôt le vivant : « Fleuve du Nord/ Souffle boréal/ Tu es mon énergie/ […]/ Des profondeurs/ Tu es lumière/ Ô Rituel de vie », scande la troupe. Ce pourrait être le cosmos tout entier que l’on fête ici, notre unité dans sa matière. Dans cette mise en espace, c’est aussi le public qui est invité à s’anonymiser, dans une communion temporaire que les masques en papier distribués par Chazeix et ceux en bois portés par les interprètes permettent de sceller. Les interprètes se meuvent dans l’espace, est-ce une parade ou une mascarade ? Si on peut voir dans les formes des visages le souffle des cultures autochtones de la côte ouest nord-américaine, elles tendent ici vers une abstraction pointant vers des rituels transculturels, puisés dans des pratiques historiquement et géographiquement très diverses. L’énergie de la fête est présente, et par l’écho de ses chants, le collectif, soutenu par une trame épique de synthétiseur, nous transporte dans une longue ascension, une envoûtante faille hors du temps de laquelle des voix jaillissent, concentrant vers chacun·e la douce charge énergétique de l’artiste.

Dans l’histoire de la sculpture, l’enjeu pour l’artiste a d’abord consisté à donner à des matériaux bruts, le plus souvent d’origine minérale ou végétale, la forme imaginée. Le travail laborieux impliquait différentes étapes allant de l’extraction de la matière à son transport et son conditionnement. Un ensemble de techniques et d’outils permettait le retrait progressif de fragments du matériau utilisé ou son insertion dans des moules aux formes déterminées. On donnait au bois, à la pierre ou au métal des configurations que ces éléments n’auraient pu prendre si ce n’était de l’intervention humaine. Pour Amélie Brindamour, si les caractéristiques individuelles des matériaux ont leur importance, c’est bien dans leurs interactions combinatoires et leur coévolution que naissent les possibilités. À la suite de passages en laboratoires universitaires et lors de sa résidence, Brindamour développe dans sa pratique l’utilisation de deux grandes catégories de biomatériaux : l’algue et le champignon. Dans son atelier, diverses opérations plastiques sont appliquées au reishi, au turkey tail et aux polypores, dont les mycéliums sont imbriqués sur des supports en toile de jute. Presque en symbiose avec sa structure textile associée, le réseau micellaire prend de l’expansion et grandit, prenant au cours de sa croissance la forme qui lui est suggérée. Dans ce processus, la matière organique est en partie à la merci des aléas environnementaux. Celle-ci peut grandir vite, mais de manière précaire si elle a trop chaud, ou peut au contraire ralentir sa croissance si elle est atteinte par le froid ou le manque de nutriments. À proximité dans l’atelier-laboratoire, l’algue est agglomérée en bioplastique, faisant apparaître des fragments translucides de polymères et des membranes diaphanes pouvant inspirer de nouvelles compositions sculpturales. Dans ces expérimentations, la pensée scientifique interdisciplinaire informe les réflexions de l’artiste, mobilisant des savoirs tels que ceux de Robin Wall Kimmerer, autrice et chercheuse membre de la nation Citizen Potawatomi qui souligne depuis une perspective autochtone l’importance des relations interespèces avec l’exemple du lichen, union primordiale du fongus et de l’algue (Braiding Sweetgrass, 2013). L’artiste réfléchit à partir de la vie micellaire et nous invite à en faire autant pour percevoir comment les frontières du soi peuvent progressivement disparaître, comment le brut et l’informe peuvent prendre corps. Par son travail, Brindamour nous montre comment l’imprévisibilité et la complexité de la métamorphose du vivant peuvent être apprivoisées et provoquer l’émerveillement par la rencontre inédite et respectueuse entre les règnes, les espèces, les idées.

Alexandre Piral par Josianne Poirier (2022)
Fort de sa formation en histoire de l’art et en sciences politiques, Alexandre Piral agit dans le milieu culturel principalement comme auteur et médiateur en art actuel. Lors de ses rencontres avec de multiples publics, il s’efforce de stimuler l’échange dans un souci d’accessibilité, de construction collective de sens et d’engagement vis-à-vis des enjeux sociaux de notre époque. Pendant son séjour en Chaudière-Appalaches, il a d’ailleurs animé un atelier d’introduction aux métiers de la culture.
Le projet qui aura occupé Piral pendant la majeure partie de sa résidence consiste toutefois en l’amorce d’un livre situé entre l’autobiographie et la mise en examen de certains pans de l’histoire du Canada, ce qu’il nomme lui-même un « récit décolonial familial » ou un « récit diplomatique » — son grand-père ayant fait carrière dans les relations internationales à titre de représentant des intérêts du pays à l’étranger. En poste à Cuba à la fin des années 1960, celui-ci a notamment côtoyé les felquistes et leurs familles qui y vivaient en exil; une improbable réunion de personnes aux allégeances fédéralistes et souverainistes. Le chapitre dédié à cette période est l’un de ceux qu’a écrits Piral à Est-Nord-Est. S’appuyant, entre autres sources, sur la collection d’ouvrages rapportés par ses grands-parents de l’île communiste, il a également conçu et construit dans les ateliers du centre, avec l’aide du technicien Richard Noury, une étagère destinée à les recevoir.
Par ailleurs, Piral compte plusieurs membres de sa famille dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Son séjour a été l’occasion de les côtoyer plus régulièrement, de les questionner sur leurs souvenirs et leurs perceptions des événements dont il traite dans le manuscrit en chantier. Tandis qu’il adopte un ton intime et situé, son désir d’interroger l’impérialisme du Canada participe à la création d’une trame narrative tendue entre le récit personnel et l’histoire nationale. La navigation à travers ces différents registres constitue l’un des défis féconds que l’auteur a dû aborder dans son processus d’écriture.


Biographie
Alexandre Piral est auteur et travailleur culturel. Né à Paris en 1991, il a grandi à Québec durant les années 2000 et vit à Montréal depuis dix ans. À l’université, il étudie les sciences politiques et l’histoire de l’art. Il travaille aujourd’hui au sein d’institutions muséales et de centres d’artistes autogérés. Il s’intéresse à l’histoire des luttes au Canada et dans le monde ainsi qu’au potentiel de l’éducation et de la médiation comme leviers d’action.